
Croître sans consommer, l’oxymore du développement durable ?
Illustré par Marie Par Lisa Evéquoz Il y a maintenant plus de 50 ans, la parole de quatre jeunes scientifiques
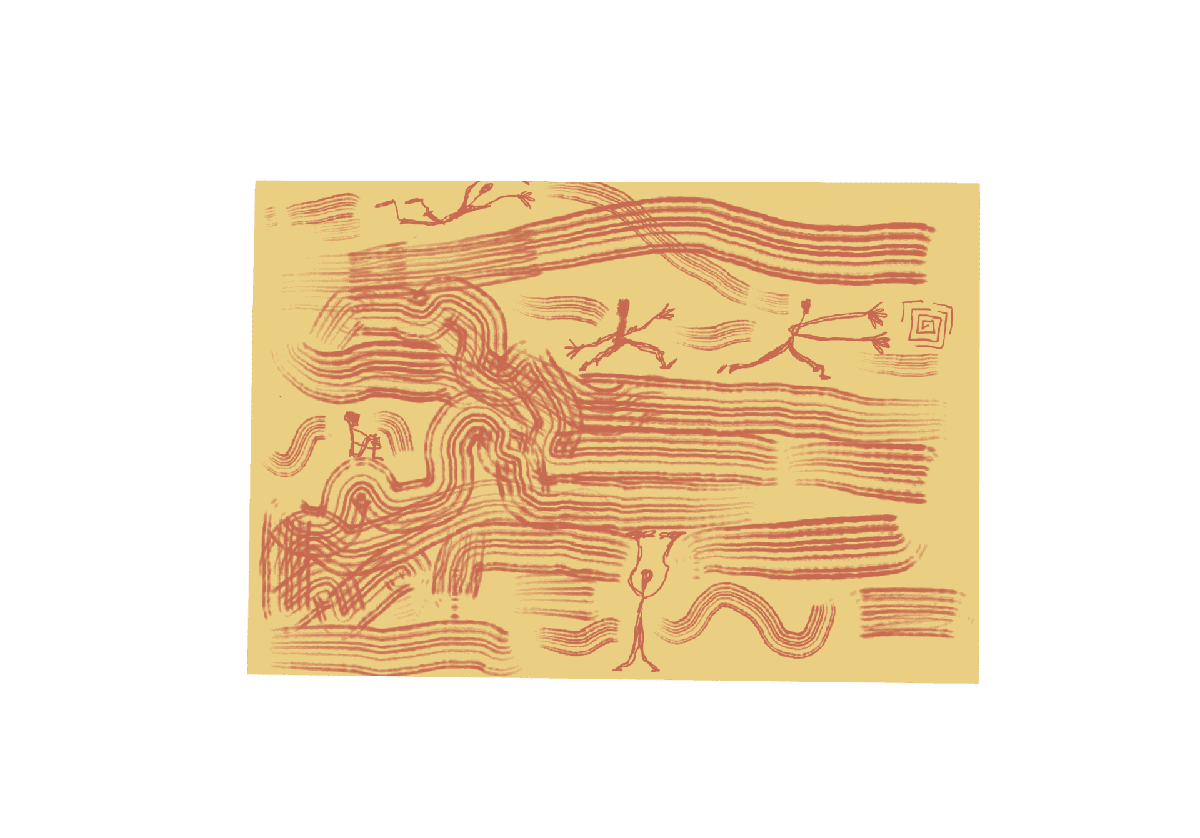
Les discours des climatosceptiques ne sont pas eux-mêmes « naturels », car ils découlent d’un énorme effort de désinformation industrielle de la part des industries en énergies fossiles. Cet effort de désinformation est documenté en détail par Naomi Oreskes et Eric Conway dans leur livre « Les Marchands de Doute ». En outre, nous savons que les industries fossiles ont développé leurs propres modèles climatiques, qui représentent clairement le rôle des émissions de gaz à effet de serre dans le réchauffement du climat : Geoffrey Supran et ses collègues ont même démontré que ces modèles étaient meilleurs que les premiers modèles du GIEC. Le rôle des émissions humaines de gaz à effet de serre dans le réchauffement climatique n’est simplement pas un sujet de débat scientifique, ou alors au même titre que la Terre serait plate. En soi, le but des climatosceptiques n’est pas très intéressant : c’est soit d’œuvrer pour les industries en énergies fossiles, soit simplement d’être leurs dupes.
Je suis simplement Auteure Principale, nous sommes quelques centaines à ce titre sur le GIEC. Le GIEC résume l’état des lieux scientifique pour le mettre à disposition du public. C’est un service essentiel étant donné l’avancée de la vaste littérature scientifique autour du réchauffement climatique. Cela permet d’établir le consensus scientifique. De surcroît, les résumés pour décideurs ont le statut de documents avalisés par les gouvernements du monde entier. C’est-à-dire qu’ils ne peuvent pas se déclarer ignorants de leur responsabilité en la matière. Les rapports du GIEC sont ainsi utilisés avec grande efficacité par les citoyens et activistes qui cherchent à mettre les gouvernements face à leurs responsabilités.
C’est très simple : le domaine politique n’est pas régi par la réalité scientifique, ni même par les intérêts des êtres humains. Il est régi par des rapports de pouvoir, des rapports de force. Actuellement, les multinationales pétrolières, gazières et charbonnières (dont Glencore, Vitol ou Trafigura, pour ne mentionner que des exemples suisses) ont beaucoup, beaucoup plus de pouvoir que les citoyens ou même les politiciens. Il suffit d’examiner l’exemple du Traité Charte sur l’Énergie (TCE) dont la Suisse refuse de se défaire : ce traité bénéficie uniquement aux industries fossiles, pas aux citoyens, et il domine sur la souveraineté nationale. Nous vivons donc dans un monde régi par les lois et pouvoirs que se donnent les multinationales, et nos mouvements citoyens n’arrivent pas encore à changer la donne.
Nous avons de bons échanges et dialogues avec les politiciens et les partis – pour la plupart. Je ne parle pas de l’extrême droite climatosceptique d’Albert Rösti, bien sûr. Mais les politiques sont désemparés par l’ampleur et l’urgence du problème. Certains arrivent à s’en saisir et remuent terre et mer pour transformer notre économie, mais d’autres sont paralysés et font l’autruche. Il faudrait sortir de cet immobilisme. Si les politiques se sentent impuissants, comparés aux lobbies fossiles, ils ont la responsabilité de communiquer haut et fort cette impasse aux citoyens. Personne n’a le droit de se sentir à l’abri ou de continuer son train-train quotidien étant donné le danger immense que court l’humanité tout entière.
Pour moi, il n’y a pas du tout d’antagonisme, mais au contraire une cohérence totale. Si nous sommes scientifiques, et que notre savoir nous informe d’un énorme danger que court l’humanité, comme les crises climatiques et écologiques, et que nous constatons l’immobilisme des sphères politiques et économiques, nous n’avons pas le choix. Il faut nous ranger aux côtés des citoyens, des activistes, descendre dans la rue, lancer l’alerte. Autrement, nous ne sommes pas responsables face à notre savoir.
Et une précision, peut-être : la science et les scientifiques ne sont pas neutres. Ils se doivent d’être objectifs et rigoureux, mais aussi de se conduire de manière éthique envers leurs concitoyens, ce qui est loin d’être neutre.
En fait, non. Mais il faut sans doute élargir nos définitions du militantisme. Je préfère “activisme”, qui indique le fait de s’activer dans la sphère publique. Nous avons avant tout besoin de citoyenneté activiste et militante : de personnes qui s’activent et qui militent pour le bien public, pour la protection de nos conditions de vie sur Terre. Cet activisme peut, et doit, se décliner en de multiples variantes : communicatives, éducatives, politiques, économiques, de travail, de culture, de loisirs, même. Mais l’époque où l’on pouvait se considérer un.e bon.n.e citoyen.ne simplement en restant bien tranquille dans son coin est définitivement révolue.
Je ne pense pas qu’il s’agit de désintérêt autant que de désespoir : les personnes ne savent simplement plus comment faire pour changer la donne. Et ce désespoir fait le bonheur des industries qui détruisent notre stabilité planétaire, autant climatique qu’écologique. Pour moi, il est crucial d’unifier les objectifs socio-économiques et écologiques, et de proposer ainsi un modèle de société réellement nouveau, se focalisant sur les besoins et le bien-être humain, sans dépasser les limites planétaires. C’est entièrement possible techniquement, mais exige de repenser nos systèmes économiques et politiques.
Très égalitaire, production et consommation focalisées sur le bien-être humain, avec prise de décisions démocratiques au cœur du fonctionnement de l’économie. Avec des citoyen.ne.s engagé.e.s activement dans la prise de décisions économiques et politiques, dans leur vie de quartier et leur travail. C’est un monde de performances technologiques, de consommation sobre, de santé, avec une culture qui retisse les liens avec le vivant. Et c’est tout à fait possible.
Nous pouvons modéliser cette utopie sur la base de la performance technologique nécessaire pour la satisfaction universelle des besoins humains. Elle est possible techniquement. Mais elle requiert une réorientation totale de nos économies pour mettre la priorité sur les besoins humains, plutôt que sur la consommation inutile, de luxe ou néfaste. Elle requiert aussi une égalité économique et politique beaucoup plus grande que ce qui existe actuellement.
Il existe une possibilité d’action, pour nous tous et toutes, ce qui est bien plus important que l’espoir.

Illustré par Marie Par Lisa Evéquoz Il y a maintenant plus de 50 ans, la parole de quatre jeunes scientifiques
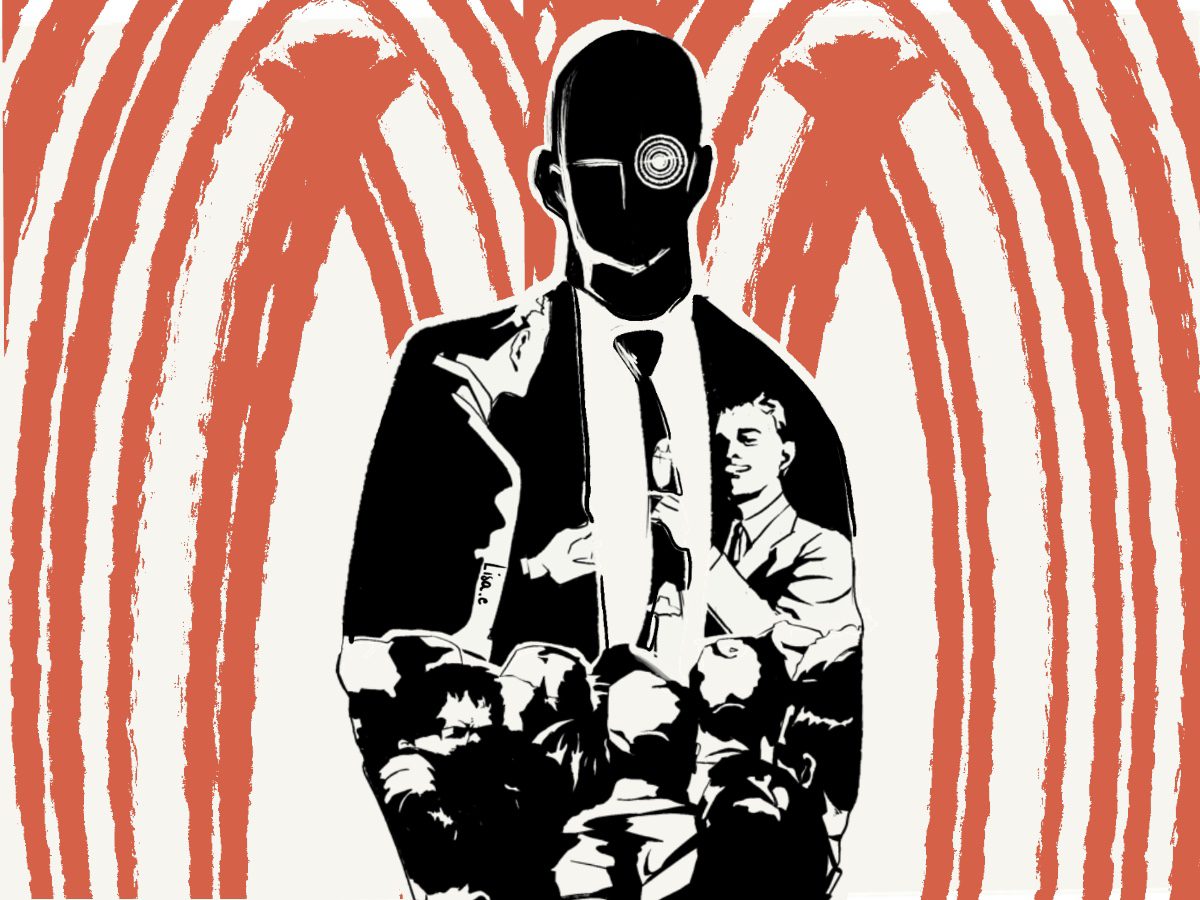
Ils façonnent l’économie mondiale, influencent les décisions politiques, investissent dans les technologies vertes ou les projets spatiaux : les milliardaires occupent une place centrale dans les débats sur l’avenir de la planète. À travers des engagements variés, mêlant bonnes intentions et stratégies, ils jouent un rôle complexe qui peut à la fois faire avancer ou freiner le développement durable. Dotés d’un pouvoir économique sans précédent, les milliardaires façonnent l’avenir. Mais leurs actions servent-elles réellement les enjeux sociaux et écologiques ?
