
Croître sans consommer, l’oxymore du développement durable ?
Illustré par Marie Par Lisa Evéquoz Il y a maintenant plus de 50 ans, la parole de quatre jeunes scientifiques
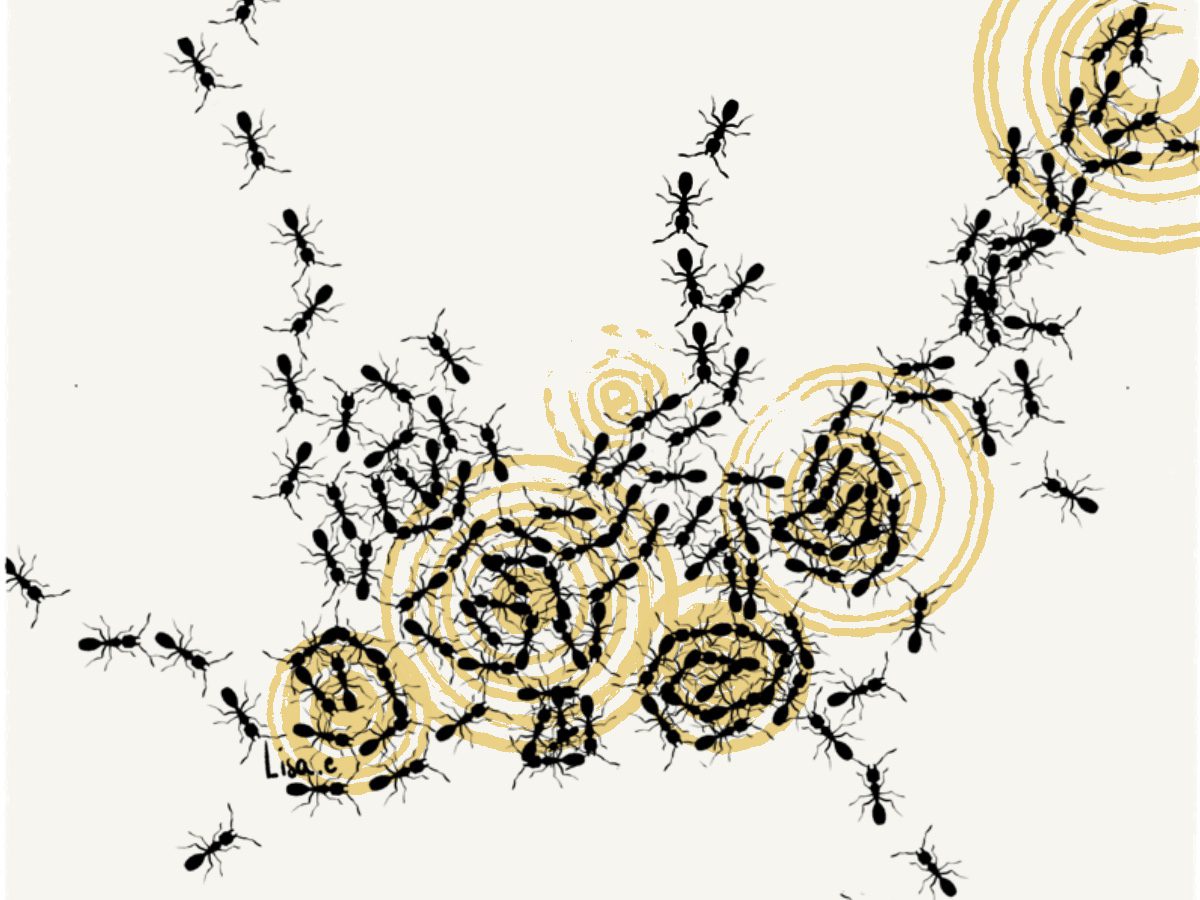
En 2009, des mails ont été volés à des scientifiques appartenant à l’université d’East Anglia. Il s’agit de l’affaire « climategate », une affaire que peut-être certain·e·s d’entre nous s’en souviennent ? Pour la faire courte, un organisme scientifique, le GIEC, a été accusé d’exagérer de manière volontaire les conséquences du réchauffement climatique. L’affaire part de mails internes, rendus publics après un piratage, dans lesquels certain·e·s climatosceptiques ont vu la preuve d’une manipulation des données.
En réalité, il s’agissait de discussions techniques usuelles entre chercheur·euse·s, dont le sens a été déformé par des extraits sortis de leur contexte. A ce propos, Rajendra Pachauri, président du GIEC de 2002 à 2015, tient les propos suivant lors de la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques de 2009, aussi appelée COP15, qui s’est tenue à Copenhague : « Les mails volés aux scientifiques de l’université susmentionnée montre que certain·e·s peuvent aller jusqu’à l’illégalité dans leur volonté de discréditer le GIEC » (Brut, 2024). Opacité, silence, secrets de couloir : le GIEC traîne cette image collante d’institution verrouillée. Un peu partout, les ouvrages climatosceptiques s’empilent, accusant sans relâche son manque de transparence. Mais qu’en est-il réellement ? Peut-on faire confiance au GIEC ?
Mais avant tout, que désigne cet acronyme de quatre lettres ? Créé en 1988, le GIEC signifie Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat, globalement connu sous son appellation anglophone IPCC. Selon son site officiel, sa mission consiste à fournir : « des évaluations détaillées de l’état des connaissances scientifiques, techniques et socio-économiques sur les changements climatiques, leurs causes, leurs répercussions potentielles et les stratégies de parade ». En d’autres mots, cela consiste à synthétiser des milliers de recherches scientifiques publiées sur la thématique du climat. Un travail pour le moins pharaonique ! Richard Alley, directeur de l’étude de 2007 ajoute lors de la COP13 à Bali : « C’est la synthèse de toute la science du monde sur le changement climatique, rassemblée, soigneusement évaluée par un groupe distingué de scientifiques avant d’être rendue publique ».
L’organisation se divise en trois groupes de scientifiques qui viennent du monde entier. Il y a tout d’abord le premier groupe, qui étudie les causes du réchauffement climatique en prenant en compte l’aspect physique du climat passé, présent et futur. Le deuxième groupe, lui, s’intéresse aux conséquences climatiques sur l’environnement et les sociétés humaines. Quant au troisième groupe, il cible les solutions à travers l’étude de moyens susceptibles d’atténuer, de maîtriser et de diminuer, entre autres, les émissions de gaz à effet de serre.
En 34 ans d’existence, six rapports ont été produits à un rythme régulier. C’est en 2021, que le dernier rapport d’évaluation a été publié. Il comprend plus de 66’000 publications scientifiques, ainsi que plus de 1043 expert·e·s provenant de 60 pays différents. Concrètement, cela représente un total de 10’538 pages, soit 20 blocs de feuille A4. Il faudrait une moyenne de 24 jours pour tout lire, et ce, sans interruption. Pas besoin de chercher la prochaine lecture, là voilà ! Un superbe bouquin, parfait pour se détendre au bord de la Sarine…
Ses membres sont-ils réellement des expert·e·s ? Ou encore, peut-on croire les rapports produits en son sein ? Voilà des questions qui surprennent, interrogent et méritent d’être entièrement posées et creusées. Un des arguments mis en avant par les climatosceptiques serait le suivant : Ce ne sont pas des vrai·e·s scientifiques. Christian Gérondeau, un essayiste et ancien fonctionnaire français, justifie cette idée à travers l’intitulé du GIEC, un acronyme n’ayant aucune référence au mot « expert ». Malgré l’absence de ce terme, ce qui dans une certaine mesure est légitimement questionnable, la procédure pour intégrer un des trois groupes de travail est complexe et méthodologique. En un mot, c’est fastidieux !
François Gemenne, un politologue et chercheur belge, en donne une explication particulièrement claire. À chaque cycle d’évaluation, les auteur·ice·s se renouvellent. Deux étapes sont suivies. D’abord, chaque gouvernement-membre sélectionne les chercheur·euse·s de son pays : ce sont surtout les ministères de l’Environnement, de la Recherche ou des Affaires étrangères qui sont impliqués. Pour la Suisse, c’est principalement l’Office fédéral de l’environnement qui pilote la sélection (De Pryck, 2022). Chaque scientifique est choisi selon des critères de compétence et de pertinence pour le rapport. Mais il faut aussi garantir une diversité de disciplines, de régions, de genres et d’expériences. Ensuite, une fois la candidature présentée au Bureau du GIEC, composé d’expert·e·s élu·e·s par l’Assemblée plénière, celui-ci sélectionne les auteur·ice·s et les affecte à différents chapitres selon leur spécialité, tout en cherchant à équilibrer pays industrialisés et pays en développement, et différentes générations de chercheur·euse·s.
Une fois qu’un premier jet est finalisé, il est offert en pâture à la communauté scientifique, qui dès lors, l’analyse et le commente. Rien que pour la partie où F. Gemenne a collaboré, ils et elles ont reçu un «bref» retour de 17’000 commentaires. Impressionnant ! Même, nous, simples citoyen·ne·s, si dans un élan de folie créative décidions de leur faire un commentaire, ces scientifiques nous répondent sans distinction. Pour autant que le commentaire soit fondé, et non pas de type facétieux, n’est-ce pas. Bref, ce sont bien des expert·e·s. Leurs rapports reposent sur des milliers d’études scientifiques, sélectionnées et évaluées selon des critères méthodologiques stricts. Chaque version préliminaire est relue, commentée et corrigée par des centaines, voire des milliers de scientifiques à travers le monde. Rien n’est publié sans avoir été soumis à ce processus collectif de relecture par les pairs.
Bien sûr, ce système n’est pas parfait : il existe des biais de sélection. Il y a souvent plus d’expert·e·s issu·e·s des pays riches ou de grandes institutions, car ils et elles ont plus de moyens ou de réseaux pour y participer. Certains gouvernements peuvent aussi proposer des profils proches de leurs positions. « Le Groupe III, par exemple, est suspecté d’avoir un “biais idéologique fort (en clair : une surdomination de l’expertise américaine)” » (De Pryck, 2022, p. 39). Même si le GIEC cherche l’équilibre, des biais persistent et certains points de vue minoritaires peuvent être écartés.
Est-ce que la réalité est exagérée ? Une question cachant une critique ! En effet, les précédentes questions reviennent souvent sous une forme accusatrice dans les discours de certain·e·s responsables politiques ou essayistes. Parmi eux, Thomas Ménagé qui accuse les expert·e·s du GIEC d’exagérer et de grossir le trait. Bref, de rendre la situation plus dramatique qu’elle ne l’est vraiment. L’idée, c’est qu’on ne devrait pas se fier uniquement à leurs rapports, sous peine d’être embarqué·e·s dans une logique de panique climatique.
Mais qu’en est-il vraiment ? D’abord, les conclusions principales du dernier rapport ne laissent pas tant de place à l’interprétation :
Alors, est-ce du catastrophisme d’avancer cela ? Le GIEC, dans sa manière de synthétiser des milliers d’études, suit un principe de consensus. C’est à dire qu’il ne tire pas ses conclusions d’une seule étude, mais d’un très grand nombre. Par exemple, si trois études évaluent un même phénomène climatique et donnent des résultats différents, l’une dit qu’il y aura 10 cm de montée des eaux, une autre 20 cm, et une troisième 30 cm, le GIEC ne choisira pas la plus alarmante. Il privilégiera plutôt l’estimation la plus basse, ou celle qui est la plus largement partagée par la communauté scientifique. Donc, ils et elles ne dramatisent pas, mais sont plutôt parfois accusé·e·s de faire preuve de trop de retenue. Ce n’est pas du sensationnalisme : c’est de la prudence mesurée. Et au fond, ne serait-ce pas souvent celles et ceux qui refusent de lire les rapports, qui reprochent à leurs auteur·e·s d’en faire trop ?
Autre critique récurrente : « le GIEC est politisé ». L’idée ici, c’est que ses conclusions seraient influencées par les gouvernements, biaisées, voire instrumentalisées à des fins diplomatiques. L’accusation paraît sérieuse. Pourtant, la réalité est, comme souvent, nuancée. Le fonctionnement du GIEC repose sur deux volets : le rapport scientifique complet, et son résumé destiné aux décideurs.
Le rapport complet de plusieurs milliers de pages est rédigé sans intervention gouvernementale. Les auteur·e·s travaillent de manière indépendante et leur méthodologie ainsi que leurs résultats sont lus, analysés et commentés par des milliers de chercheurs à l’échelle internationale. La phase politique n’intervient qu’à la fin, au moment de valider le fameux « résumé à l’intention des décideurs ». Ce document d’environ 30 pages est destiné à être lu par des ministres et des chefs d’État. Bref, des non-spécialistes. Il est donc discuté ligne par ligne, parfois mot par mot, pour qu’il puisse être endossé par l’ensemble des pays.
Ce sont les délégués des États membres, réunis en Assemblée plénière du GIEC, qui discutent et négocient ce résumé. Ces délégués sont en général des fonctionnaires issu·e·s des ministères concernés (environnement, affaires étrangères, etc.), parfois accompagné·e·s de scientifiques de leur pays. Les critères d’élection pour participer à ces discussions sont donc d’abord la nomination par chaque gouvernement, qui choisit ses représentant·e·s selon leur expertise, leur rôle institutionnel et leur expérience dans les négociations internationales. En ce qui concerne les différends, ceux-ci sont réglés par la recherche du consensus. Chaque phrase du résumé doit être approuvée par tous les États présents. Si un désaccord persiste, la formulation est modifiée jusqu’à ce qu’aucun pays n’y oppose d’objection, ou alors certains points sensibles sont retirés ou relégués en note de bas de page. Comme le dit le chercheur De Pryck (2022) : « Le consensus est donc, comme le souligne Alfred Moore, une décision “à travers les différences”, définie par la “suspension des désaccords” et l’absence d’objections à la proposition finale. ».
Est-ce que cette validation affaiblit le contenu ? Pas nécessairement. Il ne s’agit pas d’une censure, mais d’une recherche de consensus. Et surtout, le contenu scientifique du rapport complet, lui, n’est pas modifié. Même s’il n’est pas nécessairement lu par tout le monde, c’est bien ce texte-là, inaltéré, qui fonde la crédibilité de l’institution. De plus, être auteur·e pour le GIEC n’est pas synonyme de rémunération. Il ne s’agit pas d’un contrat lucratif, mais d’un engagement scientifique bénévole, souvent en plus de la charge de travail habituelle. Alors certes, toute motivation n’est pas monétaire, puisque le prestige d’avoir pu participer au GIEC est bien présent. Mais, de là à penser que ces scientifiques s’acharnent bénévolement pour servir une stratégie politique internationale, il y a un pas… qu’il me semble difficile de franchir sans mauvaise foi.
Pour clore cet article, au-delà des quelques mots que moi, profane de ce monde scientifique, pourrait rajouter en guise de synthèse, il me semble plus intéressant et vivace de rappeler à la mémoire ces quelques lignes. La liberté d’expression, ce choix de pouvoir penser et parler différemment, ou encore de pouvoir afficher fièrement son identité et ses convictions, est essentiel. Voilà, un point sur lequel, le consensus devrait être maître. Certaines informations balancées sans véracité, sans même questionner sa propre position, semble, de prime abord, être plus synonyme de bêtise qu’autre chose. Comment considérer autrement des propos « coup de poing» balancés sans aucune considération, comme D. Trump l’a fait en annonçant « Je ne crois pas au changement climatique. C’est juste la météo!». On oublie trop souvent que la liberté d’expression n’est pas un passe-droit pour dire n’importe quoi. À force de confondre opinion et vérité, on finit par transformer le débat en un simple vacarme où le bon sens disparaît.
En bref, ce qui est certain, c’est que ce qu’explique le GIEC, c’est-à-dire ses prédictions depuis plus de 30 ans, sont en train de se vérifier. Donc, pourquoi douter d’un organisme dont la seule mission est de rassembler toutes les connaissances scientifiques émises par des expert·e·s venant du monde entier ? On se doit de les croire ! Ce n’est pas une question de foi aveugle, mais un choix humain. Croire en la science, c’est choisir de miser sur la raison, l’expérience collective et la volonté de comprendre le monde pour agir au mieux. C’est accepter que, face à l’incertitude, il vaut mieux avancer avec les outils les plus fiables que nous ayons. Plutôt que de s’en remettre à l’ignorance ou à la facilité du doute. Et si cet avis-là, n’est pas partagé, cher·e lecteur·ice, continuons de questionner et de rechercher.
Je me pose une dernière question, quand bien même certaines informations pourraient être erronées, n’est-il pas favorable de chercher à construire ensemble un monde futur juste et plus vivable pour les enfants de demain ? En d’autre mots, même si une part d’incertitude demeure, agir pour le climat, c’est parier sur le meilleur. Au pire, on aura juste changé nos habitudes, sans rien perdre d’essentiel. Alors qu’au mieux, on aura offert à nos enfants une chance réelle de vivre dans un monde plus sain. Chaque petit pas, chaque petite croyance déconstruite, chaque petite pensée pour son prochain, sont autant de gouttes dans l’océan. Sans elles, il n’existerait pas. Le jeu n’en vaudrait-il pas largement la chandelle ?
Allègre, Claude, Dominique de Montvalon et Alain Bouldouyre. (2010). L’imposture climatique, ou la fausse écologie : conversations avec Dominique de Montvalon. Plon.
De Pryck, Kari. (2022). GIEC : La voix du climat. Presses de Sciences Po. https://shs.cairn.info/giec–9782724638707?lang=fr
Huet, Sylvestre. (2023). Le GIEC, urgence climat : le rapport incontestable expliqué à tous. Introduction de Jean Jouzel. Tallandier.
Foucart, Stéphane. (2015). Hoax climatique #4 : “Le GIEC manipule les données sur le climat”. Le Monde.https://www.lemonde.fr/cop21/article/2015/10/27/hoax-climatique-4-le-giec-manipule-les-donnees-sur-le-climat_4797774_4527432.html
GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat). (s. d.). Français. IPCC. https://www.ipcc.ch/languages-2/francais/
Réseau Action Climat. (s. d.). Réponses aux climatosceptiques. Réseau Action Climat. https://reseauactionclimat.org/reponses-climatosceptiques/
Brut. (2024). C’est quoi le GIEC ? YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=oc3sBoaad-c
20 Minutes. (2021). C’est quoi le GIEC ? YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=FKIAV5C-lDM
RTBF. (2024). Peut-on croire les scientifiques du GIEC ? Y a Pas de Planète B, YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=SPr5C5GG8jU
Jean Jouzel, Michel Petit et Valérie Masson-Delmotte. (2018). Trente ans d’histoire du Giec. La Météorologie, 100 Spécial Anniversaire 25 ans, 117-124. https://doi.org/10.4267/2042/65154
Jouzel, Jean. (2015). Une expertise collective sur le climat : le fonctionnement du GIEC. Études, 2015/6, 7-18. https://www.cairn.info/revue-etudes-2015-6-page-7.htm
Mollard, Éric. (2010). Claude Allègre contre le GIEC : de l’arme du faible. Natures Sciences Sociétés, 18(2), 190-194. https://stm.cairn.info/revue-natures-sciences-societes-2010-2-page-190?lang=fr

Illustré par Marie Par Lisa Evéquoz Il y a maintenant plus de 50 ans, la parole de quatre jeunes scientifiques
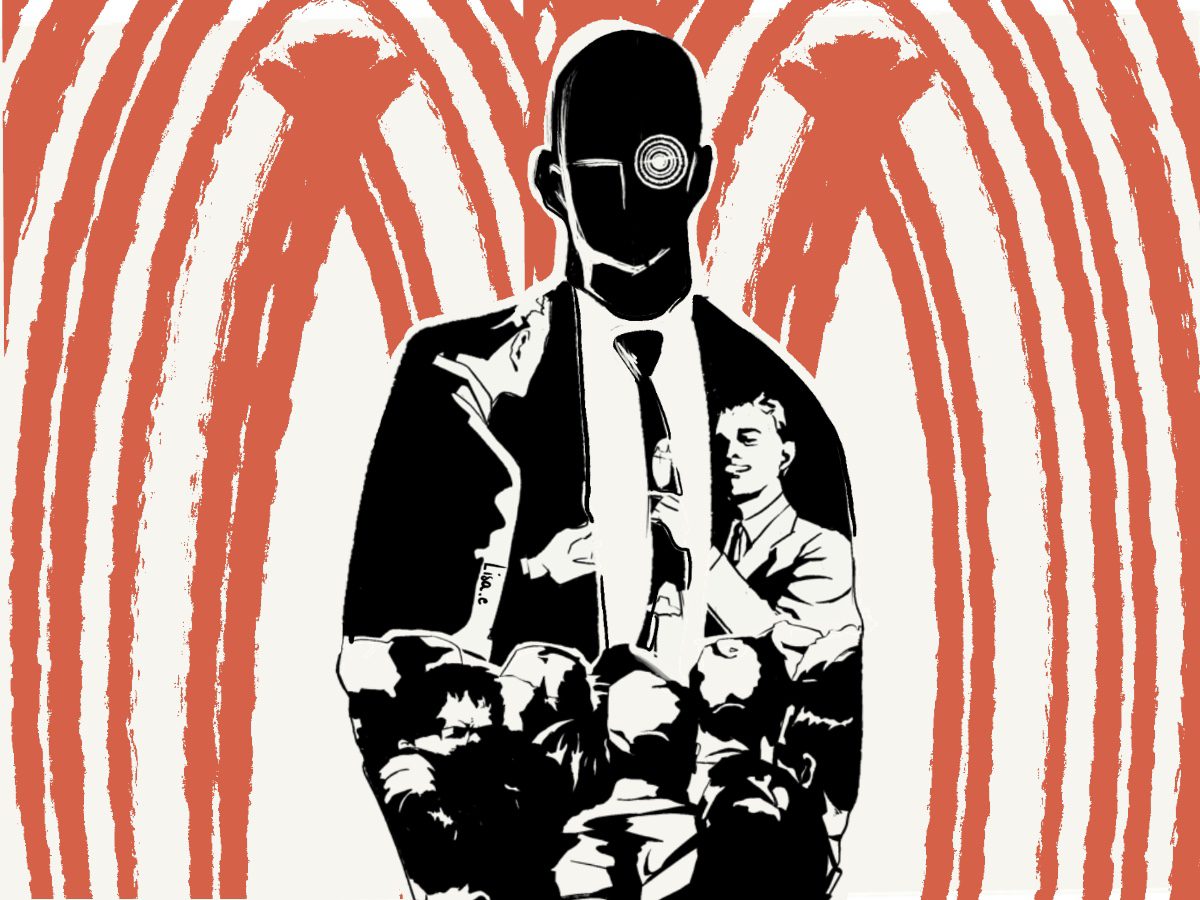
Ils façonnent l’économie mondiale, influencent les décisions politiques, investissent dans les technologies vertes ou les projets spatiaux : les milliardaires occupent une place centrale dans les débats sur l’avenir de la planète. À travers des engagements variés, mêlant bonnes intentions et stratégies, ils jouent un rôle complexe qui peut à la fois faire avancer ou freiner le développement durable. Dotés d’un pouvoir économique sans précédent, les milliardaires façonnent l’avenir. Mais leurs actions servent-elles réellement les enjeux sociaux et écologiques ?
